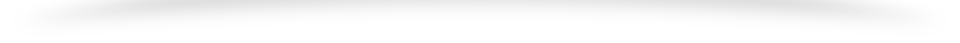Le prolapsus génital, souvent désigné par l’expression « descente d’organes », correspond à l’affaissement.
Bien qu’il ne mette pas en jeu le pronostic vital, il peut causer des symptômes gênants : urinaires ou digestifs. Le traitement a pour but de soulager ces symptômes, de restaurer la fonction pelvienne et de limiter le risque de récidive.
1. Comprendre le prolapsus génital
Le plancher pelvien agit comme un hamac musculaire qui soutient les organes pelviens. Lorsque cette structure se détend ou se fragilise, les organes peuvent descendre et faire de la protrusion dans le vagin.
On distingue plusieurs formes :
- Hystérocèle : descente de l’utérus.
- Prolapsus de la voûte vaginale : souvent après hystérectomie.
Les causes sont multiples : accouchements, ménopause, obésité, efforts physiques répétés, constipation chronique, toux persistante, ou facteurs héréditaires.
2. Les traitements conservateurs
a. Rééducation périnéale
La rééducation vise à renforcer les muscles pelviens. Les exercices de Kegel, réalisés régulièrement, permettent d’améliorer la tonicité musculaire et le soutien des organes.
b. Pessaires vaginaux
Un pessaire est un dispositif en silicone inséré dans le vagin pour maintenir les organes en place. C’est une option non invasive, réversible, souvent adaptée aux femmes âgées, aux patientes en attente de chirurgie ou à celles qui souhaitent éviter une intervention. Des contrôles réguliers préviennent les irritations et les infections.
c. Traitement hormonal local
Chez les femmes ménopausées, l’application d’œstrogènes locaux (crèmes, ovules, anneaux) améliore l’élasticité et la résistance des tissus vaginaux, réduisant l’inconfort et facilitant le port du pessaire.
d. Modifications du mode de vie
Certaines habitudes contribuent à limiter la progression du prolapsus :
- éviter le port de charges lourdes,
- maintenir un poids de forme,
- pratiquer des activités physiques douces comme la marche ou le yoga,
- traiter la toux chronique.
3. Les traitements chirurgicaux
Lorsque le prolapsus est sévère (grades III ou IV) ou très invalidant, la chirurgie est souvent nécessaire. Elle vise à repositionner les organes et à restaurer la solidité du plancher pelvien.
a. Chirurgie par voie vaginale
Elle consiste à intervenir directement par le vagin, ce qui permet une récupération rapide.
- Colporraphie antérieure ou postérieure : réparation des parois vaginales affaissées.
- Hystérectomie vaginale : retrait de l’utérus en cas de prolapsus utérin avancé.
- Suspension de la voûte vaginale : fixation à des structures solides pour prévenir la récidive.
b. Chirurgie par voie abdominale ou laparoscopique
La sacrocolpopexie est la technique de référence, notamment chez les femmes jeunes ou actives. Elle consiste à fixer le vagin ou l’utérus au promontoire sacré à l’aide d’une bandelette synthétique. Cette approche, réalisée par laparotomie, cœlioscopie ou chirurgie robot-assistée, garantit un excellent maintien à long terme.
c. Techniques conservant l’utérus
Pour les patientes souhaitant préserver leur fertilité ou éviter l’hystérectomie, l’utéropéxie repositionne et fixe l’utérus, par voie vaginale ou abdominale.
4. Suites opératoires et prévention des récidives
Les consignes incluent :
- repos relatif,
- reprendre les rapports sexuels uniquement après cicatrisation complète,
- suivre un programme de rééducation périnéale post-opératoire.
- maintenir un poids stable,
- prévenir la constipation,
- effectuer un suivi gynécologique annuel.
Conclusion
Le traitement du prolapsus génital doit être adapté à chaque patiente, en tenant compte de la gravité, des symptômes, de l’âge et des projets de vie. Grâce aux progrès médicaux, il est aujourd’hui possible d’obtenir un soulagement durable, de restaurer la fonction pelvienne et de préserver la qualité de vie.
Une prise en charge précoce et personnalisée, associée à une prévention active, reste la clé pour éviter les complications et les récidives.
Pour une meilleure pris en charge, voir TRAITEMENT PROLAPSUS GENITAL CASABLANCA